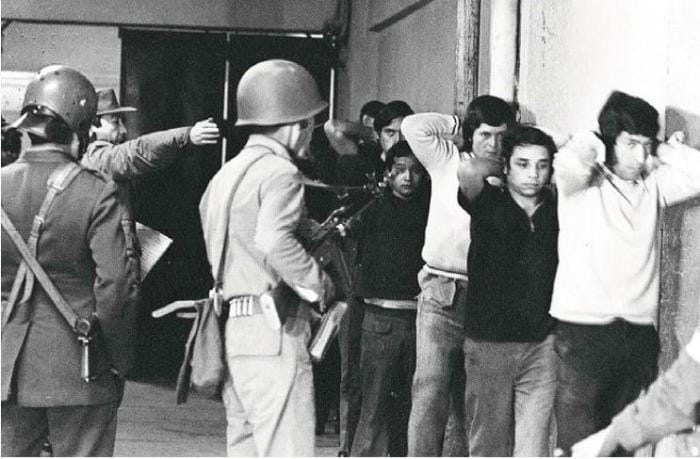Les conditions de travail des domestiques sont très dures
La chambre du domestique

Pour être plus à portée d’accomplir leur service, à toute heure, les domestiques sont logés par leurs maîtres, dans l’appartement même, ou à l’écart, dans les fameuses « chambres de bonnes » au dernier étage des immeubles. Dans l’appartement, un cagibi, un débarras, sans fenêtre le plus souvent, s’ouvrant sur la cuisine, lui sert de refuge. Il y a tout juste assez de place pour un mauvais lit de fer et une chaise. Encore est-ce là le confort ! Car bien des bonnes n’ont qu’un lit pliant dans la cuisine. On cite même des maîtres qui, le soir venu, disposent une paillasse dans le fond de leur baignoire, pour y faire dormir leur servante. Toute vie personnelle de la bonne est ainsi confisquée. On comprend que, si le choix est possible, celle-ci préfère encore le « sixième », malgré tous ses inconvénients.
Avec les grands travaux d’urbanisme, le prix des terrains augmente. Dans les immeubles plus hauts, les appartements sont plus étroits. Aussi relègue-t-on les domestiques loin de l’intimité familiale, dans les chambres mansardées du dernier étage, accessibles par le seul escalier de service. Ces « sixièmes » ont provoqué de violentes diatribes, et laissé de tristes souvenirs par leur terrible inconfort. En l’absence de tout système de chauffage, l’eau gèle dans les brocs en hiver, mais en été, on étouffe sous les mansardes. Un faible jour perce au travers des lucarnes qui parfois ouvrent sur la rue, mais le plus souvent donnent sur les courettes des immeubles, courettes dont l’air est plus que vicié par les cuisines qui s’ouvrent aussi dessus.
Dans les meilleurs des cas, un unique poste d’eau alimente l’étage, où l’on peut trouver jusqu’à plus de trente chambres. La rudesse des conditions de vie, le manque d’hygiène, l’insalubrité y sont tels que les sixièmes, véritables foyers de tuberculose, soulèvent de vives dénonciations de la part des médecins. La promiscuité qui règne à cet étage entre domestiques des deux sexes, dans des chambres fermant mal et séparées par de trop minces cloisons, achève de faire des sixièmes un monde physiquement et psychologiquement difficile à supporter, où se développent l’angoisse et les névroses. C’est cependant le seul lieu où les serviteurs peuvent jouir, pour quelques heures, d’un peu de liberté et de vie personnelle. En province, où les sixièmes existent peu ou pas, la condition domestique est encore plus dure.
Le salaire du domestique est toujours très bas
Les salaires sont très bas, surtout en province. Comme par le passé, ils sont réglés par l’usage, et liés à la capacité, au crédit du domestique et à son sexe. Remarquons qu’il s’agit bien maintenant d’un salaire, rétribuant une location d’ouvrage, et non plus de gages. A ce salaire proprement dit s’ajoutent le pourboire (de plus en plus interdit), les étrennes (1 mois à 1 mois 1/2 de salaire en 1900), les gratifications et cadeaux, plus les avantages reconnus : le don de vêtements, la vente des graisses et des cendres, le « sou du franc ».
La nourriture fait partie des avantages en nature, mais, sauf dans les grandes maisons, elle est plus que médiocre et souvent insuffisante : soupe au déjeuner, pain, bouillon et desserte de la table des maîtres. C’est sur ce poste que l’on fait de sordides économies, afin de pouvoir s’offrir une servante nécessaire au prestige social. Ainsi voit-on des bonnes mourir de faim…
Les conditions de travail du domestique sont très dures
 Les conditions de travail sont très dures. Dans les grandes maisons, la répartition précise des tâches permet une moindre pesanteur du service. Mais pour la bonne à tout faire… Que l’on imagine ce que représente l’entretien d’une maison sans chauffage central en corvée de bois et de charbon, surtout aux étages les plus hauts d’immeubles sans ascenseur ; en corvée d’eau pour le nettoyage de l’appartement, la toilette, la cuisine, la lessive… quand l’eau courante n’existe pas.
Les conditions de travail sont très dures. Dans les grandes maisons, la répartition précise des tâches permet une moindre pesanteur du service. Mais pour la bonne à tout faire… Que l’on imagine ce que représente l’entretien d’une maison sans chauffage central en corvée de bois et de charbon, surtout aux étages les plus hauts d’immeubles sans ascenseur ; en corvée d’eau pour le nettoyage de l’appartement, la toilette, la cuisine, la lessive… quand l’eau courante n’existe pas.
En l’absence de produits d’entretien performants, quel travail que de laver et frotter les parquets, astiquer les cuivres. Il faut faire la poussière, non plus superficiellement comme autrefois, mais dans les moindres recoins d’appartements croulant sous les tissus, encombrés de petits meubles et de bibelots en tous genres. Et puis, il y a la cuisine, l’enfer. Etriquée, sans autre aération que par une petit fenêtre sur cour, surchauffée par le fourneau et la lessiveuse, saturée d’humidité par les vapeurs et le linge qui sèche, et de la plus grande saleté. La cuisinière, la bonne à tout faire qui y passent leur vie, dans une atmosphère viciée, y attrapent le fameux « rhumatisme des cuisinières », la tuberculose, s’y intoxiquent par l’oxyde de carbone, deviennent alcooliques.