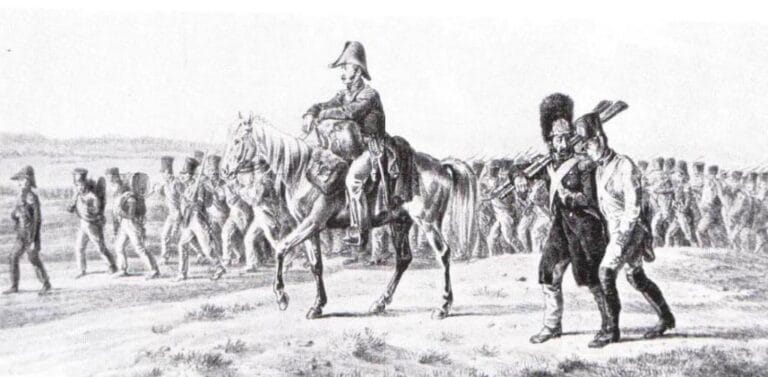Le fusil, arme de base du soldat de Napoléon 1er
- L’essentiel
La Grande Guerre a popularisé l’image du Poilu et de son fidèle Lebel. Dans le même esprit, on peut écrire que, sous l’Empire, le meilleur ami du soldat qui part pour la guerre, c’est son arme : fusil pour le fantassin, sabre pour le cavalier, voire canon pour l’artilleur.
Le maniement du fusil du soldat de Napoléon
 Le fusil de soldat de Napoléon est long de 1 mètre 52, il pèse 4 kilos 375 ; son calibre est de 17,5 millimètres ; ses garnitures sont en fer.
Le fusil de soldat de Napoléon est long de 1 mètre 52, il pèse 4 kilos 375 ; son calibre est de 17,5 millimètres ; ses garnitures sont en fer.
La manœuvre en est lente : le tireur ouvre d’abord le bassinet, puis ayant déchiré la cartouche avec les dents, remplit de poudre le bassinet et le referme. Il verse ensuite le restant de la charge de poudre dans le canon et bourre par deux fois l’enveloppe de la cartouche avec la baguette, introduisant la balle entourée des deux épaisseurs de papier.
Il arme alors le chien, dont le silex, quand il est de bonne qualité, suffit pour cinquante coups. Les balles de plomb sont de vingt à la livre. La poudre dite de munition est aussi bien utilisée pour les armes portatives que pour le service de l’artillerie : c’est un mélange de trois quarts de salpêtre, un huitième de charbon, un huitième de soufre, en grains relativement gros, trois cents à quatre cents au gramme. Elle encrasse rapidement le canon du fusil, qui doit être lavé au chiffon après cinquante ou soixante coups, puis séché et graissé.
La vitesse d’un tireur exercé était de deux coups-minute, et le silex « ratait» en moyenne une fois sur quinze, ce qui était considéré comme honorable.
Le tir était précis entre cent et deux cents mètres, et encore efficace jusqu’à quatre cent cinquante ou cinq cents mètres ; l’arme ne comportant pas de hausse, le soldat tirait alors un peu au jugé, en faisant une correction avec son pouce gauche. Aucune protection de la platine n’étant prévue, le soldat la mettait à l’abri de l’humidité en l’entourant de chiffons ou du mouchoir.
Le problème du remplacement du fusil

En 1806, l’Empereur ne dispose guère que de 350 000 fusils en bon état et très rapidement se posera, pour l’armement comme pour les autres fournitures essentielles, le problème du remplacement.
Une bataille comme Austerlitz, dira Napoléon, coûte plus de douze mille fusils, dont dix mille sont cassés par les boulets, ou abandonnés par les blessés. Les besoins entraînés par les augmentations des effectifs ne sont satisfaits que très difficilement : les fabrications ne suivent pas, et les renforts qui rejoignaient la Grande Armée arrivaient au corps le plus souvent les mains vides. Il faudrait une fabrication annuelle de 200 000 fusils là où l’on n’en obtient à peine 145 000 et la perte durant la même période est de 150 000.
Là aussi la saisie des arsenaux prussiens et autrichiens va permettre de combler provisoirement le déficit. Leurs fusils sont, heureusement, du même calibre que les nôtres, ce qui évite des complications de munitions.
On imagine mal l’insouciance des soldats, qui perdent, égarent, oublient leur fusil dans les cantonnements d’étapes sans parler des baïonnettes, qui disparaissent au point que certains corps les font payer au soldat sur sa masse d’habillement, pour le contraindre à plus d’attention.
Le blessé abandonne son fusil sur le champ de bataille ou l’utilise comme béquille pour gagner l’ambulance. Après Eylau, on a fait ramasser des milliers d’armes sur le terrain ; le lendemain de la bataille de Wagram, on donne trente sous pour chaque fusil apporté au village de Spitz et quinze sous par baïonnette, ou fusil incomplet.
Napoléon doit aussi pourvoir aux besoins des alliés : il envoie en Pologne, en 1809, 10 000 fusils prussiens, ainsi que 1 000 sabres, et 3 000 paires de pistolets, tirés des arsenaux de Magdebourg. La fabrication française ne dépassant guère 120 000 fusils d’infanterie par an, l’Empereur suggère que l’on reprenne la fabrication du fusil républicain n° 1 pour armer les gardes nationales. Cette arme était montée avec des pièces dépareillées de toutes sortes ; elle présente l’avantage évident d’un prix de revient très bas, et l’inconvénient de ne pas valoir grand-chose !