La famine terrorise


Si le visage de Paris s'est tout de même assombri depuis quelque temps, c'est beaucoup moins par des raisons politiques ou sentimentales que pour des causes purement matérielles. Chaque jour, huit cent mille personnes éprouvent plus de difficultés à faire bouillir leur marmite. Pénurie des denrées, vie chère, tel est le fléau qui s'abat sur la capitale comme sur le reste du pays.
Ces embarras sont aussi vieux que la Révolution ; ils l'ont même précédée de quelques mois. Au printemps de 1789, le ravitaillement de la grande ville était déjà devenu précaire. Précédente récolte mauvaise, accaparements de la spéculation, pillages locaux dans les campagnes, tout s'était conjugué pour empêcher les grains d'arriver normalement et le résultat en avait été un pain noir d'une saveur amère et d'une digestion difficile, un pain vraiment national, en ce sens qu'il « donnait la colique » à toute la population.
Encore était-il des plus rares et fallait-il se le disputer comme une marchandise précieuse. Plus d'une fois les boulangers avaient menacé de fermer boutique, plus d'une fois le pauvre Bailly, voyant les greniers de Corbeil et de Nogent-sur-Seine complètement vides, s'était demandé comment ses électeurs allaient pouvoir manger le lendemain.
Ces embarras sont aussi vieux que la Révolution ; ils l'ont même précédée de quelques mois. Au printemps de 1789, le ravitaillement de la grande ville était déjà devenu précaire. Précédente récolte mauvaise, accaparements de la spéculation, pillages locaux dans les campagnes, tout s'était conjugué pour empêcher les grains d'arriver normalement et le résultat en avait été un pain noir d'une saveur amère et d'une digestion difficile, un pain vraiment national, en ce sens qu'il « donnait la colique » à toute la population.
Encore était-il des plus rares et fallait-il se le disputer comme une marchandise précieuse. Plus d'une fois les boulangers avaient menacé de fermer boutique, plus d'une fois le pauvre Bailly, voyant les greniers de Corbeil et de Nogent-sur-Seine complètement vides, s'était demandé comment ses électeurs allaient pouvoir manger le lendemain.
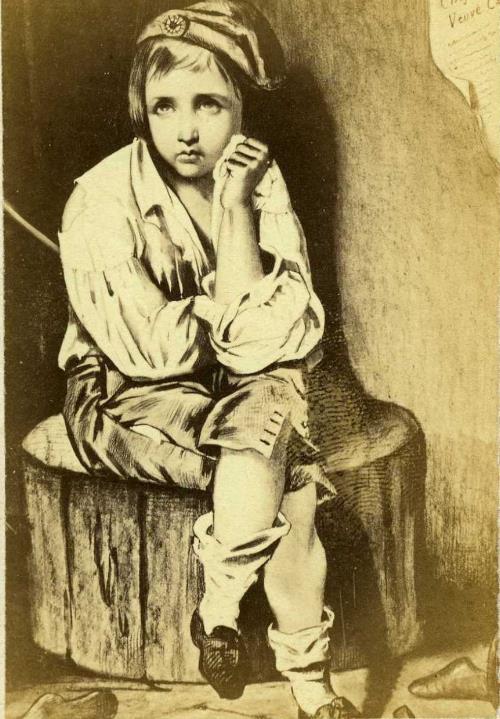
Pour beaucoup de troubles, pas d'autre cause que cette angoisse quotidienne, que cet énervement d'une foule que la famine terrorise. Heureusement tout s'est d'abord arrangé. La province est venue au secours de la capitale; on a vu repasser sur les routes de beaux sacs gonflés de froment. Et, douze mois plus tard, on s'est retrouvé encore en vie, rassuré par une récolte qui, cette fois, a été bonne.
Rien ne prouve mieux le rétablissement de l'équilibre que les prix des restaurants en 1790. Sans parler de maisons comme Méot que fréquente la société riche et où l'on fait, pour huit ou dix livres, des repas dignes de Lucullus, servis dans de la vaisselle d'argent, le client moyen peut confortablement dîner chez Trianon, rue des Boucheries-Saint-Germain, ou chez un bon traiteur de la rue des Petits-Pères, en dépensant à peine trente sols.
De plus modestes établissements, comme il y en a dans la Cité, donnent pour dix sous la soupe, le bouilli, une entrée et un demi-verre de vin.
Telle est encore la « vie chère » au moment de la Fédération, et voilà de quoi justifier le bon moral des Parisiens.
Rien ne prouve mieux le rétablissement de l'équilibre que les prix des restaurants en 1790. Sans parler de maisons comme Méot que fréquente la société riche et où l'on fait, pour huit ou dix livres, des repas dignes de Lucullus, servis dans de la vaisselle d'argent, le client moyen peut confortablement dîner chez Trianon, rue des Boucheries-Saint-Germain, ou chez un bon traiteur de la rue des Petits-Pères, en dépensant à peine trente sols.
De plus modestes établissements, comme il y en a dans la Cité, donnent pour dix sous la soupe, le bouilli, une entrée et un demi-verre de vin.
Telle est encore la « vie chère » au moment de la Fédération, et voilà de quoi justifier le bon moral des Parisiens.
Pas de grands changements l'année suivante. Un jeune Bisontin de dix-neuf ans, Claude-Ferdinand Faivre, fils d'un ancien procureur au Parlement, qui arrive de sa province dans les derniers jours de juillet, est étonné de la bonne chère qu'il fait, non seulement à Paris, mais tout le long de son voyage.
Le trajet depuis Besançon n'a été qu'une série de bombances. On a mangé, au relais d'Auxonne, une carpe de douze livres, sablé le champagne à Troyes, emporté dans la voiture un fort panier de bouteilles pour arroser, en cours de route, des poulets froids, de la pâtisserie, un énorme panier d'abricots, et tout le monde a si bien bu, si bien ri et si bien chanté que, lorsqu'on débarque enfin dans la cour des Messageries, notre garçon ne tient plus sur ses jambes.
Quand huit heures de sommeil l'ont à peu près remis d'aplomb, il se fait conduire chez un traiteur. Le salon est tout garni de glaces. On peut choisir ce qu'on désire sur une carte impressionnante, mais les prix semblent fort modestes :
« On m'a servi, écrit le jeune homme à son père, un potage au vermicelle dans lequel il y avait au moins deux assiettes creuses ordinaires, un gros morceau de mouton et des herbes dessous, du beau pain et le tout pour quatorze sols six deniers le plat et deux sols de pain. Dans un plat, il y en a pour deux...»
N'est-ce pas un pays de cocagne?
Le trajet depuis Besançon n'a été qu'une série de bombances. On a mangé, au relais d'Auxonne, une carpe de douze livres, sablé le champagne à Troyes, emporté dans la voiture un fort panier de bouteilles pour arroser, en cours de route, des poulets froids, de la pâtisserie, un énorme panier d'abricots, et tout le monde a si bien bu, si bien ri et si bien chanté que, lorsqu'on débarque enfin dans la cour des Messageries, notre garçon ne tient plus sur ses jambes.
Quand huit heures de sommeil l'ont à peu près remis d'aplomb, il se fait conduire chez un traiteur. Le salon est tout garni de glaces. On peut choisir ce qu'on désire sur une carte impressionnante, mais les prix semblent fort modestes :
« On m'a servi, écrit le jeune homme à son père, un potage au vermicelle dans lequel il y avait au moins deux assiettes creuses ordinaires, un gros morceau de mouton et des herbes dessous, du beau pain et le tout pour quatorze sols six deniers le plat et deux sols de pain. Dans un plat, il y en a pour deux...»
N'est-ce pas un pays de cocagne?

